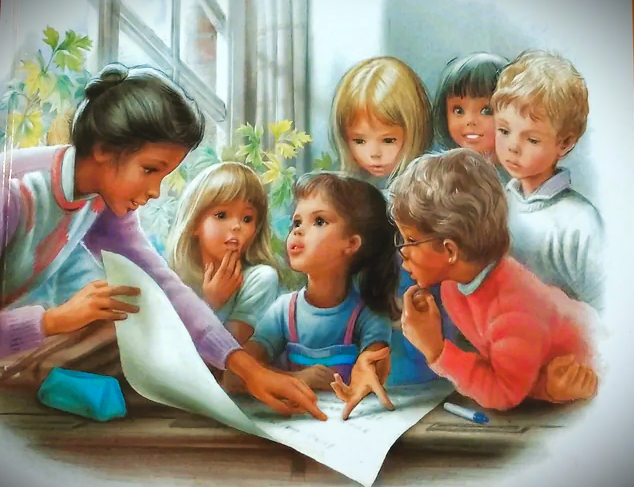
La dictée rituelle comme outil de construction des règles orthographiques et d'ouverture au monde
Cet article envisage la dictée comme un moyen de parler de l'actualité et d'acquérir l'orthographe ordinaire du français courant.
Non, la dictée n’est pas une pratique bannie dans l’enseignement, comme d’aucuns le croient. Dans le programme du 1er degré de l'Enseignement secondaire catholique de 20051 (qui vit, il est vrai, ses dernières heures avant son remplacement par une version nourrie par le FRALA2), ce mot est cité à sept reprises (mais, certes, sur deux pages seulement). Cette pratique est essentiellement évoquée dans la fiche 5, qui consiste à faire rédiger des savoirs de langue ; on recommande en particulier dans le programme les dictées qui consistent à construire le savoir orthographique et non à l’évaluer, c’est-à-dire celles qui s’accompagnent d’une négociation entre les élèves ou entre l’enseignant et les élèves concernant les choix orthographiques à effectuer.
Des textes « fabriqués »
La dictée n’est sans doute pas bannie, mais il faut admettre que certains textes créés de toutes pièces pour mettre l’élève en difficulté sont susceptibles de provoquer chez l’auditeur le sentiment bizarre d’évoluer dans un mode parallèle, étrangement peu soumis aux aléas de l’actualité, monde policé qui ne détonnerait pas dans un album de Martine, mais rendu invivable par les pièges graphiques en tout genre qu’un démiurge malintentionné y aurait disséminés. Lisez plutôt :
Déjà, les fleurettes printanières émaillent les parterres, les perce-neige, crocus et primevères qui nous ont éblouis annoncent le printemps. Et pourtant ! Ce jour-là, au lever, en tirant les tentures, quelle surprise ! La neige que l’on n’avait pas vue du tout cet hiver, couvrait les toits et les pelouses qui avaient reverdi. Cette blancheur, d’une épaisseur de quelques centimètres, faisait la nique au renouveau. Les flocons virevoltaient comme des papillons, ivres de liberté et de joie. Oui, ce n’était pas normal, mais tellement ravissant qu’on ne pouvait s’en plaindre. Les enfants qui n’avaient pas encore rangé leur(s) bonnet(s) s’ébattaient heureux dans cet univers magique autant que surprenant et inattendu.
Il s’agit là d’une dictée de concours, non destinée, à priori, à l’enseignement. Elle provient du site officiel de la dictée du Balfroid, « concours convivial et ludique [qui entend éveiller] les enfants à la richesse de la langue française et à son orthographe3 ».
Sur ce même site, on trouve le texte suivant, qui rappelle aux distraits que le chat était à l’origine un petit carnassier dépourvu de la moindre considération pour notre espèce :
Un petit chat imprévisible
Tout beau, exceptionnellement beau, il est arrivé au grand bonheur de sa famille adoptive.
Chacun a cajolé le chaton, qui avait caché un grand défaut. Las des caresses que la maîtresse de maison lui avait attribuées, il se rendit soudain agressif. De ses deux incisives extrêmement pointues, il l'avait tout à coup mordue. Depuis cette grande première, il fallait s'en méfier. [...]
Vous me direz que l’essentiel ne réside pas dans la richesse du texte sur le plan sémantique, mais plutôt dans la complexité orthographique qu’il offre. Et il est vrai que ces textes recèlent des accords qui suscitent la réflexion et peuvent donner lieu, en classe, à des échanges pertinents :
- Pourquoi avaient reverdi sans s ?
- Pourquoi ont éblouis avec s ?
- Pourquoi deux orthographes possibles pour leur(s) bonnet(s) ?
- Que signifie las ? Pourquoi ce s ? Etc.
L'une de mes réserves à l'égard de ces textes est la suivante : dans la mesure où ils ont été rédigés pour un concours d'orthographe, l’élève qui subit la dictée va naturellement soupçonner de nombreux pièges tendus par un auteur sournois, même s'il s'avère en fin de compte que les accords qu'elle contient sont absolument réguliers. Il va donc se focaliser sur ces prétendus pièges et, redoutant des exceptions qu’il ne maitrise pas toujours, en arrivera à se méfier de ses propres raisonnements – qu’il jugera trop évidents - pour privilégier des choix incongrus… C’est le travers dans lequel tombent parfois les étudiants. Ils n’appliquent pas telle ou telle règle, pourtant requise dans un cas précis, parce qu’ils jugent ce cas, à tort, exceptionnel. En somme, les règles sont connues, mais leurs conditions d’application pâtissent d’une défiance excessive de la part du scripteur.
Cependant, on pourrait tourner ce problème en vertu, et proposer aux élèves les textes du Balfroid pour qu'ils confortent leur confiance en soi et leur maitrise de ce que l'on appelle en didactique les savoirs conditionnels, c'est-à-dire leurs capacités à identifier sereinement et précisément les conditions concrètes d'application des règles orthographiques qu'ils ont apprises.
En réalité, je choisis rarement de tels textes (textes « fabriqués », créés uniquement pour être dictés) pour une autre raison : ils font la part belle aux accords compliqués et, du fait de leur non-ancrage dans l'actualité, ont tendance à négliger des problèmes orthographiques pourtant lancinants pour les étudiants qui y sont confrontés : comment gère-t-on l'emploi de la majuscule dans les noms de lieux, d'institutions ou d'associations ? ; écrit-on parfois une majuscule après les deux-points ? ; comment écrit-on les sigles et acronymes ? ; comment écrit-on les nombres dans un texte courant ? ; comment note-t-on les fractions et les pourcentages ? ; etc. ?
Des textes authentiques
Voici trois exemples de textes que je privilégie pour mes dictées en haute école, parce qu’ils sont authentiques (et non pédagogiques), c’est-à-dire motivés uniquement par une intention de communication « vraie » avec des francophones, contiennent de nombreux « problèmes » orthographiques variés et courants et donnent la possibilité d’articuler l’orthographe avec une discussion sur le monde qui nous entoure.
Et si on laissait les forêts wallonnes se débrouiller toutes seules ? Trois quarts des Wallons demandent "la liberté" pour les arbres
Selon une nouvelle étude de l'ULiège, 76 % des Wallons souhaitent davantage de forêts protégées en libre évolution. Cette approche, où l'homme n'intervient pas, représente un levier concret pour répondre aux exigences régionales et européennes en matière d'aires protégées, selon l'ASBL Forêt et Naturalité. Reportage dans une telle forêt "en liberté", à Vierves-sur-Viroin4. [...]
Les oiseaux migrateurs sympathisent la nuit
18300 heures de vocalisations enregistrées lors de vols nocturnes, au-dessus de l’Amérique du Nord, montrent que les volatiles socialisent avec des membres de trois autres espèces en moyenne. Il faut bien faire la conversation…5
Un milliard cent septante-trois millions d'euros pour sa construction et son exploitation jusqu'en 2052. Deux ans et demi de retard. Des centaines d'heures de palabres politiques et d'innombrables reports. Le tram fut assurément le chantier de la décennie (voire du siècle ?) pour Liège, une ville pourtant déjà éprouvée par une série de travaux interminables par le passé. Mais dans la Cité des Princes-Evêques, la patience s'apprête (enfin) à être récompensée. Ce lundi 28 avril, le tram accueille ses premiers passagers pour sillonner les 11,7 kilomètres qui séparent Coronmeuse de Sclessin. L'occasion pour La Libre de revenir sur ce feuilleton aux allures de chemin de croix6.
Choix des textes
Les textes dictés proviennent de la presse et sont sélectionnés en fonction de leur date de parution, des faits qu'ils abordent et de leur compréhensibilité par le public visé. Ils fournissent notamment l'occasion d'évoquer l'actualité et de lier culture générale et raisonnement orthographique. Ainsi, la majuscule du point cardinal dans Amérique du Nord signale qu'il s'agit de l'appellation ordinaire du sous-continent américain septentrional. On pourrait également discuter de l'usage de la majuscule dans l'expression Cité des Princes-Evêques, où aucune règle n'impose son emploi à aucun des mots (nous n'avons pas réellement affaire à un nom propre mais à une expression périphrastique) ! Peut-être pourrait-on, comme dans mont Blanc ou rue de la Paix, laisser la minuscule au nom générique (la cité) et mettre la majuscule au terme spécifique7 (des Princes-Evêques, la principauté de Liège ayant été dirigée depuis 980 jusqu'à la Révolution française par des princes-évêques) ? Mais l'appellation cité des princes-évêques étant stylistique et non officielle, mieux vaut sans doute laisser la possibilité d'écrire le tout en minuscules.
Fréquence
Les textes sont en général courts. Quelques phrases suffisent. L’exercice n’est pas chronophage et peut se répéter chaque semaine. De tels textes peuvent être présentés aux élèves dès la 5e primaire.
Méthodologie
Le texte est d’abord lu par l’enseignant puis paraphrasé par la classe. Les élèves sont invités à le reformuler, en s’aidant éventuellement de quelques mots interrogatifs clés : qui ? Quoi ? Où ? Quand ?... Il est essentiel que cette évocation du sens du texte précède la mise à l’écrit de l'extrait, car l'établissement de liens entre supports (ce dont on parle) et apports (ce qu'on en dit) que cette évocation suppose facilite globalement la gestion des accords.
Le sens des mots nouveaux est inféré par les élèves puis complété par l’enseignant ; ces mots sont notés au tableau pour faciliter la suite du déroulement. (L’orthographe des noms propres peut également figurer au tableau.)
Le texte est ensuite dicté par l’enseignant. Ce dernier s’efforce de ne pas s’interrompre au milieu d’un syntagme ou d’un groupe rythmique. Il calque son rythme de dictée sur la vitesse d’écriture des élèves les plus lents, qu'il suit des yeux.
Par deux, les élèves révisent leur texte. Ils discutent pour parvenir à une version finale du texte qui leur convienne. Ils essaient autant que possible de s’appuyer sur des règles connues et formulent des hypothèses de règles pour les cas méconnus. Ils tracent des flèches dans leurs copies entre les apports et leurs supports pour justifier les accords.
Variante : la dictée zéro faute8, appelée également dictée dialoguée. Après chaque phrase dictée, l’enseignant s’interrompt et donne à ses élèves le temps de poser toutes les questions qu’ils souhaitent concernant l’orthographe de la phrase qu’ils viennent d’écrire. L’enseignant ne répond pas à ces questions ; il adresse à la classe des sous-questions pour faire réfléchir les élèves et les mettre sur la voie de la réponse. Ainsi, peu à peu, l’élève apprend à repérer les graphies problématiques au sein de ses écrits et à les corriger opportunément.
Je suggère un recours au numérique pour la socialisation. L’enseignant utilisera son GSM à des fins pédagogiques. Il photographie la copie révisée (et lisible) d’un élève et la projette au tableau électronique. Les accords sont justifiés par les élèves eux-mêmes et des hypothèses sont formulées pour les cas inédits.
Ensuite, le texte original est projeté et les éventuelles divergences orthographiques sont encore discutées.
Exemples de cas susceptibles de donner lieu à des discussions
- Toutes seules s’accorde avec quel mots ? Quelle est la règle pour accorder seul lorsqu’il semble caractériser un verbe (emploi adverbial) plutôt qu’un nom seul ? Et lorsque tout est adverbe, dans quels cas doit-on l’accorder ?
- Comment écrit-on pour cent dans la presse quotidienne ? Et dans les revues scientifiques ? Et dans mes écrits futurs ? (Y a-t-il encore des contexte où l’on écrit pour cent en lettres ?)
- Pourquoi écrit-on en lettres trois autres espèces, en chiffres 18300 heures et de nouveau en lettres un milliard cent septante-trois millions ? Quelles sont vos hypothèses ?
- Pourquoi écrit-on des Wallons avec une majuscule et forêts wallonnes avec une minuscule ?
- Etes-vous d’accord avec le choix de l’auteur qui écrit la Cité des Princes-Evêques ? N’aurait-il pas pu écrire la cité des princes-évêques ?
- ASBL peut-il s’écrire sans point abréviatif après chaque lettre ?
- Comment écrit-on et demi ? Et demi-heure ?
- Interminable s’accorde-t-il avec série ou travaux ? Le choix est-il permis ?
- Comment écrivez-vous accueil ? D’une manière générale, comment écrivez-vous le son [œj] ? Ecrivez sous ma dictée seuil, écureuil, et feuille, puis cueillir, orgueil et accueil. Que constatez-vous ? Comment s’explique cette différence ?
- Amérique du Nord ou Amérique du nord ? Dans quels cas faut-il écrire les points cardinaux avec la majuscule ?
Etcétéra ! Les questions sont si nombreuses que l’on a tout intérêt à dicter de brefs paragraphes, sans quoi ces exercices phagocyteront d’importantes parties de leçons…
Un recueil de règles
Toutes les réponses à ces questions pourront être rassemblées dans une espèce de mémento, document évolutif qui accompagnera les élèves à chaque dictée et dans lequel les commentaires seront classés par mots (ou phonogrammes) clés, eux-mêmes ordonnés alphabétiquement.
Exemples :
- -euil : pour noter [œj], on écrit -ueil après g ou c pour garantir la prononciation [g] ou [k] et -euil dans les autres cas.
- Demi varie en genre dans une heure et demie, trois poulets et demi, deux cuillères et demie de sel, mais demeure invariable dans une demi-heure, une demi-pomme, etc.
- Habitants : les noms qui dérivent d’un nom de lieu et désignent les habitants de ce lieu prennent la majuscule : une Esneutoise, un Wallon, une Liégeoise… Lorsqu’ils sont adjectifs, ces mots s’écrivent avec une minuscule : une linguiste esneutoise, le tram liégeois, une étudiante wallonne.
- Seul s’accorde avec le nom auquel il se rapporte logiquement, même lorsqu’il signifie individuellement. Exemple : Elles ont construit cette cabane seules.
- Sigle : un sigle (ou un acronyme) s’écrit généralement en majuscules et sans points abréviatifs : ASBL, ONU, OLP, UE, OTAN, OGM…
Conclusion
Vous voyez que les textes authentiques, du fait qu’ils sont ancrés dans une situation de communication actuelle, en éclairent le sens, permettent de « brasser plus large », en matière d’orthographe, que les documents « fabriqués » cités en début d’article, focalisés sur des difficultés plutôt « scolaires ». Etant donné qu’il s’agit de textes courants, ils font découvrir des particularités orthographiques ordinaires, banales, auxquelles l’élève a de nombreuses chances d’être confronté dans ses propres écrits tout au long de sa vie.
Cela étant dit, les textes de concours, présentés comme tels et assortis de conseils psychologiques (« Ce sont des textes écrits pour un concours d’orthographe, ne voyez pas le mal partout, calmez-vous, raisonnez comme d’habitude, logiquement, en établissant des rapports de sens… »), pourraient constituer de petites évaluations sommatives (mais non certificatives) organisées sous forme de pseudo-compétitions par équipes (avec concertation possible et à la clé pour les vainqueurs, l’honneur de rédiger le texte de la dictée suivante). Alors, là, oui, la dictée du Balfroid deviendrait ludique9. Et l’on aurait tort de croire que les dictées du Balfroid évoquent uniquement un monde où le pire qui puisse nous arriver, c’est d’être mordu par un chat. En atteste la dictée suivante, proposée en 2022 :
Que de catastrophes se sont abattues sur notre monde ces derniers temps ! Il serait vain et difficile de les dénombrer.
En ce qui nous concerne, le confinement que nous avons subi n’a duré que trop longtemps. On s’en remet à peine.
Après les files interminables que nous avons connues afin de nous faire vacciner, nous voilà débarrassés du masque protecteur.
L’été dernier, des inondations spectaculaires ont appauvri bien des gens.
Maintenant, nous élargissons notre compassion à un autre pays subissant les terreurs de la guerre.
L’humanité, néanmoins, prend le dessus en accueillant les nombreux réfugiés qui ont réussi à fuir l’agresseur.
Regardons l’avenir avec moins de crainte(s) et que l’espoir renaisse enfin !
Et, au risque de me répéter d'article en article, l'ouvrage de référence qui m'aide à théoriser l'orthographe (et plus largement la plupart des questions de langue liées à l'école) avec souplesse et rationalité demeure Le Bon usage, de Maurice Grevisse et André Goosse10. Malgré son volume rebutant, l'ouvrage est facilement consultable par le biais de son index.
Pierre-Yves Duchâteau
Image d'illustration : Delahaye G., Marlier M. (1993). Martine à l'école, Paris, Casterman.
1. Al Charif C., Balzat C., Bonkowski S., Dooms M., Jusseret F., Mauclet M.-F., Pétré A. et Vanschepdael J.-L. (2005). Programme - français - 1er degré commun. Enseignement secondaire catholique.
2. Fédération Wallonie-Bruxelles. (2022). Référentiel de français - langues anciennes.
3. Les dictées du Balfroid citées dans cet articles sont lisibles sur ce site : https://www.la-dictee-du-balfroid.be/les-dictees/
4. Devillers S. (2025). « Et si on laissait les forêts wallonnes se débrouiller toutes seules ? », La Libre Belgique, n° 116-117.
5. Nouyrigat V. (2025). « Les oiseaux migrateurs sympathisent la nuit », Epsilon, n° 47, p. 87.
6. Gobiet N. (2025). « Du projet de rêve au cauchemar à ciel ouvert : retour sur la saga du tram du Liège », La Libre Belgique, n° 118.
7. Il semble s'agir de la solution retenue par La Libre Belgique, à en croire les nombreuses occurrences de « cité des Princes-Evêques » parmi ses pages. Mais ce n'est pas celle préconisée par l'Office québécois de la langue française, lequel précise que « les appellations employées par antonomase (périphrases descriptives ou caractéristiques) pour désigner un État, un territoire, une région ou une ville prennent une majuscule initiale ». Ainsi, « on appelle Paris la Ville lumière ». Https://vitrinelinguistique.oq...
8. Cogis D., Brissaud C., Carole Fischer C. et Nadeau M., sous la direction de S. Chartrand (2016). « L’enseignement de l’orthographe grammaticale », Mieux enseigner la grammaire, Editions du Renouveau pédagogique.
9. À propos des dictées du Balfroid, on lira avec intérêt l'étude suivante, où l'on épingle notamment leur exigence en matière d'orthographe grammaticale, peu adaptée aux enfants du primaire : Dister A., Moreau M.-L. (2019). « Le poids de l’orthographe grammaticale et de l’orthographe lexicale dans les dictées », L’orthographe : pratiques d’élèves, pratiques d’enseignants, représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, pp. 21-42.
10. Grevisse M. et Goosse A. (2011). Le Bon Usage, De Boeck Université.


