
Irons-nous encore au Salon de l'auto ?
Quelques documents pour réfléchir en classe à l'avenir de l'automobile...
Un anachronisme !
Le 9 janvier dernier, à l’occasion de l’ouverture du Salon de l’auto, François Heureux, animateur de 7 à 9 heures d’une partie de la tranche matinale d’informations sur la Première (RTBF), se demandait s’il était encore possible de s’offrir un véhicule à l’heure actuelle, étant donné le prix élevé d’une voiture neuve. Le « dossier » de son émission était consacré à cette question, et les auditeurs étaient invités à y réagir. Je m’attendais de la part du service public à une mise en perspective un peu plus large de cette manifestation, questionnant notamment la soutenabilité du marché de l’automobile individuelle1 à l’heure du changement climatique global, mais il n’en fut rien. Seul le cout prohibitif de certains modèles fut alors abordé.
Il semble en fait que la RTBF soutienne l’évènement, comme en témoigne le texte ci-dessous, qui annonce la présence d’animateurs de Classic 21 à cette foire commerciale2 :

Classic 21 en direct du Salon de l’Auto 2025
A la recherche d'un nouveau véhicule ? Ou tout simplement envie de rêver un peu ? Cette année encore, Classic 21 sera LA radio du Salon de l’Auto avec plus de 30 heures en direct de Brussels Expo. L'équipe sera là pour vous guider dans vos choix avec de nombreux invités issus du secteur automobile qui passeront par notre studio sur place.
Fanny Gillard et Dominique Dricot vous partageaient les coulisses de la soirée d’inauguration du Salon de l’Auto le vendredi 10 janvier entre 19h30 et 23h avec quelques invités de marque qu’ils ont reçu (sic) au cours d’une émission VIP dont les images sont à revoir ci-dessus.
[...]
Entrez dans un monde d’innovation, de technologie et de passion pure lors de la 101e édition du Salon de l’Auto, le rendez-vous incontournable des amateurs de voitures et des professionnels.
Un Salon pour tous les goûts
Une expérience inégalée sur 56.000 m², avec plus de 100 exposants et 63 marques automobiles et véhicules utilitaires légers présentant les derniers modèles, technologies et tendances. Avec 90,4% du marché automobile belge représenté, cet événement façonne l’avenir de la mobilité individuelle.
Car l’avenir de la mobilité individuelle, doit-on lire entre les lignes, c’est de toute évidence l’automobile !
Il faudra tout de même, tant que l’état du monde nous permet encore de nous consacrer à des tâches relativement peu urgentes comme l’écriture de l’histoire, se pencher sérieusement sur la responsabilité des médias dans la réticence des gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour préserver l’espèce humaine (non, non, je ne cède pas à un catastrophisme facile et je pèse mes mots). Ce travail d’enquête a d’ailleurs été entamé par la chaine de journalisme indépendante Blast et a donné un podcast très instructif :
Mais soyons de bon compte avec la RTBF : Tendances Première, magazine radio diffusé de 10 à 11h30 sur la Première (RTBF), a consacré son émission du 17 janvier dernier3 à la question du respect des droits humains dans les exploitations minières qui produisent un matériau indispensable à la fabrication des batteries, le cobalt. Audacieux, d’autant que cette émission était réalisée dans les salles mêmes du Salon de l’auto et pointait du doigt la négligence en matière d’industrie extractive de certains grands fabricants de véhicules.
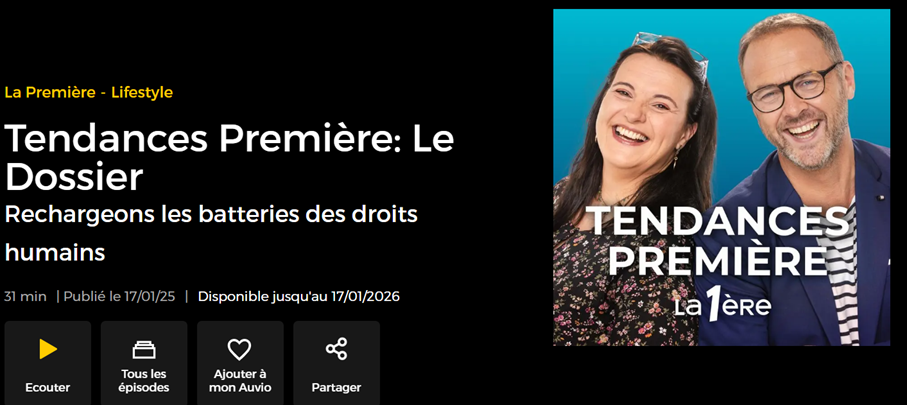
Il était toutefois possible de poursuivre la réflexion au-delà du domaine des droits humains : les activités extractives ne nuisent pas seulement aux droits des femmes et des hommes, elles émettent également du CO2 tout en salissant l’environnement et en épuisant les ressources en eau, comme le montre l’entretien suivant avec la journaliste Célia Izoard, réalisé par la chaine Blast, déjà citée dans ces lignes.
Cet entretien s’ouvre sur un extrait du livre de Célia Izoard, La Ruée minière au XXIe siècle4 : « Continuer à faire croire qu’il est possible de supprimer les émissions carbones en électrifiant le système énergétique mondial est un mensonge criminel. » On notera à ce propos que c’est à peu près dans ce travers que sont tombés les animateurs de Tendances Première ce 17 janvier : nous laisser croire que l’électrification du secteur automobile est acceptable à condition que les composants des batteries soient extraits dans des conditions sociales acceptables. L’ont-ils fait de leur plein gré ? Reconnaissons qu’il est délicat, lorsqu’on partage des locaux avec les acteurs d’une foire commerciale, de jeter trop ouvertement l’anathème sur le produit exposé dans ladite foire.
Lorsque je pense au Salon de l’auto, me vient immédiatement à l’esprit le terme anachronisme. Au lieu d’électrifier tête baissée l’ensemble du parc automobile de la planète, il est à présent urgent de réduire ce parc et, avant tout, de repenser globalement notre mobilité. Tout à ma recherche d’un article qui me conforterait dans mes convictions et me fournirait des arguments chiffrés, j’ai donc introduit ces mots dans le barre de recherche de Google : salon, auto et anachronisme, croyant fermement que ce dernier terme m’éviterait les articles trop ouvertement laudateurs envers la voiture. Voici l’un des résultats sur lesquels je suis tombé, publié en février 2024 :
Post de Eric GORTEMAN 5
Le Salon de l’Auto en Belgique : Tradition incontournable et vecteur de dynamisme
Janvier en Belgique rime avec le Salon de l’Auto, une institution qui, malgré l’absence de l’édition organisée par la FEBIAC cette année, a su maintenir son influence indéniable sur les ventes automobiles. [...] En effet, le Salon de l’Auto de Bruxelles, dont la première édition remonte à 1902, est plus qu’un événement : c'est un pilier de notre culture automobile nationale, un moment clé gravé dans l’inconscient collectif belge. Et cette année ne déroge pas à la règle, malgré l’absence physique du Salon. Les marques ont redoublé d’efforts pour rejoindre leur public, prouvant que la tradition du Salon de janvier reste vivante et vibrante, même à travers des canaux alternatifs. Cet événement est si particulier qu’il suscite l’envie chez nos homologues étrangers, admiratifs de ce phénomène unique au monde qui réussit, année après année, à créer un moment de communion exceptionnel autour de l’automobile. Fort de 19 éditions à mon actif, je peux témoigner de l’impact profond de cet événement sur notre secteur : chaque mois de janvier, comme mes tous mes confrères, je vis - je mange - je dors au rythme du Salon, absorbé par cette effervescence qui ne laisse personne indifférent. C’est là toute la raison de mon plaidoyer aujourd’hui : si le Salon de l’Auto en Belgique doit évoluer, s’adapter aux nouvelles réalités de notre époque, il est essentiel de préserver son essence. Nous, membres de la FEBIAC et acteurs du secteur, devons tout mettre en œuvre pour que cette célébration de l’automobile, cette vitrine exceptionnelle de notre industrie, continue de briller. Renouveler, moderniser, oui, mais toujours dans l’objectif de perpétuer cette tradition qui nous définit et nous unit. Ainsi, loin d’être une anachronisme, le Salon de l’Auto de Bruxelles doit être envisagé comme une opportunité de renouvellement et de dynamisation de notre secteur. C’est notre responsabilité, en tant que professionnels passionnés, de veiller à ce que cette tradition perdure, se réinvente, et continue d’inspirer les générations futures.
L’on apprend dans ce texte (il s’agit d’un « post », soyons précis), rédigé par un professionnel dont l’emploi dépend de la survie du secteur, que le Salon de l’auto est un pilier de la culture nationale belge et que cette manifestation n’est nullement anachronique, dans la mesure où elle contribue au nécessaire renouvèlement (technologique ?) d'un marché dont le fleuron, l'automobile, mérite d’être célébré. Il est vrai que ce post est publié sur Linkedin, réseau sur lequel échangent en vase clos des professionnels que l’on imagine mal ternir leur commerce.
Parmi les résultats, un autre document : cet éditorial du quotidien Libération6, écrit à propos du Mondial de l’auto parisien de 2024. Cette fois, le caractère anachronique est attribué à la communication autour de l’évènement, laquelle célébrait les bolides à gros moteur. Sans remettre en cause la tenue de cette exposition, l’auteur se contente d’appeler de ses vœux, pour l’édition de 2025, une publicité plus axée sur la décarbonation de l’automobile.

Mondial de l’auto à Paris : face au défi des voitures électriques, les clichés ont la vie dure
L'édito de Paul Quinio
La promotion du salon international de l’automobile, qui s’ouvre ce lundi à Paris, met en avant de grosses cylindrées. Une com quelque peu anachronique à l’heure des enjeux des véhicules décarbonés pour les constructeurs européens.
Malgré le coup de frein enregistré cette année côté ventes, l’avenir de la voiture se situe bien du côté des véhicules décarbonés.
C’est une affiche qui en dit long. Elle figure en tête du site du Mondial de l’auto qui s’ouvre à Paris ce lundi 14 octobre, pour une semaine. «Let’s celebrate !» est-il écrit. Le visuel qui accompagne cette invitation à faire la fête ne laisse pas de doute sur ce qu’il s’agit de célébrer, puisqu’il montre un bolide à grosses jantes sur un fond violet explosif. Les clichés ont donc la vie dure. Dans la tête des consommateurs, on s’en doutait un peu. Qui, sans être nécessairement un fana des bagnoles XXL ou des caisses de compet, n’a jamais marqué le pas sur un trottoir au passage d’une belle voiture, ou kiffé sur la route en testant la puissance de la nouvelle acquisition d’un copain ?
En revanche, on s’étonne un peu plus de constater que dans la tête de ceux dont c’est le métier d’en faire la promotion, la voiture continue de rimer avec grosse cylindrée, allure de préférence sportive et performances surpuissantes. Un chouïa anachronique, alors que l’interdiction de la vente de voitures thermiques et hybrides est prévue, sauf changement de cap des instances européennes, pour 2035. Un chouïa surtout à côté des préoccupations industrielles et économiques du secteur, les constructeurs étant tous plus ou moins concentrés sur la transition vers l’électrique. Car malgré le coup de frein enregistré cette année côté ventes, l’avenir de la voiture se situe bien du côté des véhicules décarbonés. La compétition entre fabricants fait rage.
Notre reportage dans le fief munichois de BMW, en pleine restructuration pour s’imposer comme le géant européen de la voiture, le prouve. Renault profitera aussi du salon qui s’ouvre pour promouvoir sa nouvelle R5 électrique. La bataille entre Etats, Chine, Etats-Unis, Union européenne, sur fond de mesures plus ou moins protectionnistes, bat aussi son plein. Les enjeux industriels, économiques mais aussi sociaux sont évidemment colossaux. Mais ils ne sont en réalité qu’une réponse au défi encore plus colossal de la transition écologique. Nourrissons donc un espoir : que l’affiche 2025 du Mondial de l’auto soit un tout petit peu plus verte…
Enfin, une autre recherche m’a mené à cet article, repéré sur le site de Canopea, association qui fédère les organisation actives dans la défense de l’environnement. Ce texte démontre, chiffres éloquents à l’appui, que la voiture individuelle est un modèle réellement anachronique parce que hautement nuisible en termes d’occupation du sol, de finances publiques, de consommation d’eau et d’énergie, de dégâts aux infrastructures, d’émissions de CO2 et de déchets… Tout est dit : la voiture, thermique ou électrique, ne peut constituer l’avenir de la mobilité.
Mais de tout cela, il semble que nous préférons ne rien savoir, tout occupés que nous sommes à faire face le plus pragmatiquement possible aux impératifs de notre vie quotidienne… et un peu abandonnés des grands médias qui ménagent la chèvre et le chou, et de gouvernements successifs qui décidément ne prennent pas la mesure des défis environnementaux, soucieux qu’ils sont sans doute de ne pas effrayer l’électeur.
Voici un extrait de cet article bien documenté, que vous trouverez en intégralité sur canopea.be.
Les petits ruisseaux de la mobilité
Pierre Courbe
[...] En cette période de salon de l’automobile, il nous a semblé intéressant de réaliser quelques rapides petits calculs pour illustrer que la manière dont les Belges « consomment de la voiture » n’est pas non plus très « bonne » et que même la simple généralisation des comportements des « plus automobilistes » à l’ensemble de la population belge ne peut être raisonnablement envisagée.
Qu’en est-il du parc automobile actuel ?
Le parc automobile belge comptait 6 089 564 unités au 1er août 2024.
Selon une analyse du Service public fédéral Mobilité et Transports (SPF MT), du fait de l’accroissement du nombre de voitures et de leurs dimensions, « en 2023, l’ensemble du parc automobile occupait 9 787 terrains de football, soit 1 422 de plus que dix ans plus tôt. »
Dans cette même analyse, le SPF MT nous apprend que la longueur médiane des voitures belges est de 4,55 m. Mises bout à bout, les plus de 6 millions de voitures présentes sur les routes belges représentent donc une file de 27 708 km. Plus de la moitié du tour de la terre, quand même … ou encore 104 fois la distance Bastogne-Ostende (267 km par la route). Compte tenu de la largeur médiane des voitures (1,83 m selon le SPF MT), si l’on colle côte à côte (flanc contre flanc) 104 voitures, la largeur cumulée est de 190 m. Ainsi, en plaçant toutes les voitures belges parechoc contre parechoc pour former 104 files continues de 267 km de long et en plaçant ces files l’une contre l’autre, on « barrerait » donc la Belgique d’ouest en est d’un énorme trait de carrosseries de 190 m de large …
Nombre de voitures par ménage
L’enquête Monitor menée par le SPF MT nous apprend que 16% des ménages belges ne possèdent pas de voitures, 51% en possèdent une, 27% en possèdent deux et 6% trois ou plus. Et si tous les ménages disposaient de deux voitures, qu’est-ce que cela impliquerait en termes d’espace occupé ? Un simple petit calcul de coin de table permet de conclure que le parc automobile augmenterait de 63%, passant alors à 9,9 millions de véhicules… ce qui représenterait non plus 104 mais 169 fois la distance Bastogne-Ostende. Le trait de carrosseries barrant la Belgique passerait donc de 190 à 309 m d’épaisseur. Plus prosaïquement, il faudrait, pour accueillir toutes ces voitures supplémentaires, augmenter très fortement non seulement les capacités du réseau routier mais également les places pouvant accueillir ces véhicules lorsqu’ils ne roulent pas. Car – on l’oublie souvent – une voiture reste stationnaire la plupart du temps. Sur base d’un kilométrage moyen d’environ 15 000 km/an et d’une vitesse moyenne de 46,5 km/h (celle du cycle de test officiel des voitures), la durée d’utilisation est de 323 heures/an. Une voiture reste donc immobile 96,3% du temps … Toutes ces adaptations ne seraient évidemment pas sans conséquences sur les finances publiques … ce qui serait bien embêtant en ces temps de contrainte budgétaire. C’est la direction dans laquelle nous pousse le secteur automobile – dans laquelle nous nous laissons docilement pousser. [...]
Ouvrir les élèves à ces réalités
Les élèves ne peuvent ignorer les enjeux relatifs au marché de l’automobile et à la mobilité en général. Ce sont les électeurs de demain et l’école doit leur apprendre à effectuer des choix réfléchis, c’est-à-dire des choix qui prennent en compte des paramètres élargis et pas uniquement leurs intérêts personnels.
Pour autant que la question d’ouverture des discussions soit susceptible d’impliquer les élèves, la forme du débat, genre communicationnel fréquemment cité dans le Référentiel de français et langues anciennes, me parait être particulièrement propice à la découverte de cette problématique. En effet, grâce à un échange de vues nourries de lectures préalables, les élèves auront l'occasion d'affiner leur point de vue sur une réalité susceptible d'impacter leur avenir.
Du puzzle au débat
Le modèle du puzzle, défendu par Philippe Meirieu8 pour améliorer les apprentissages lors des travaux de groupes, s’avère particulièrement indiqué pour découvrir des problématiques aux multiples facettes comme celle qui nous occupe.
Comment cela fonctionne-t-il ? Des groupes sont d’abord constitués. Chaque groupe se penche sur un ou plusieurs des documents précités. Certains groupes devraient pouvoir s’isoler pour visionner les vidéos ou écouter une émission de radio. Dans chaque groupe, on aboutit à une fiche informative (une fiche par élève) résumant le document analysé :
Auteur, profession :
Date de parution :
Destinataires du document :
Sujet du document :
Position de l’auteur du texte :
Arguments cités par l’auteur pour défendre/étayer sa position :
L’enseignant passe dans les groupes pour vérifier que les fiches sont suffisamment complètes.
Ensuite, les groupes sont dissouts. De nouveaux groupes sont constitués, dont chaque membre aura analysé un document différent. Muni d’un éclairage particulier sur la thématique de l’automobile, chacun des membres sera précieux pour l’établissement d’une synthèse (chacun détient une pièce du puzzle qu’il s’agit de reconstituer), qui peut prendre la forme d’une carte mentale ou d’un tableau reprenant les informations principales glanées dans les documents. Une porte d’entrée parmi d’autre dans ces documents : les classer selon qu’ils proposent des arguments (1) en faveur de la voiture, qu’elle soit thermique ou électrique, (2) en faveur de la voiture décarbonée (électrique), (3) opposés globalement à la voiture individuelle.
Des cartes mentales élaborées sous une forme numérique favoriseront leur socialisation. L’une l’elles sera projetée et présentée par ses auteurs ; les autres groupes suggèreront des amendements qui seront en temps réels implémentés par l’enseignant (devenu « techno-scribe » de la classe).
Munis d’une carte mentale de référence, les élèves se prépareront au débat en rédigeant seuls deux arguments appuyant leur réponse à la question abordée. Cette question pourrait être la suivante : Pourrons-nous encore nous déplacer en voiture lorsque nous serons adultes ? Elle présente l’avantage d’impliquer l’élève (« nous »), de le projeter dans son avenir et d'interroger - c'est bien là l'essentiel - le bien-fondé du recours systématique à la voiture individuelle.
Vient ensuite le moment du débat, animé par l’enseignant, qui veillera à ce que tous les élèves s’expriment à plusieurs reprises afin que les points de vue s'affinent et se nuancent. S’il y a plus de 20 élèves dans la classe, il a sans doute intérêt à procéder à deux débats successifs auxquels participeraient 10 élèves, les 10 autres ayant alors une fonction d’observateurs : ils noteront les réussites en matière d’expression verbale et paraverbale des débatteurs.
Dans les débats surgiront sans doute des réflexions sur la difficulté de se passer de voiture dans un environnement largement forgé pour la voiture. On pourra donc, autres documents à l’appui, imaginer d’autres configurations spatiales de l’habitat, des services, de l’industrie… pour que la voiture devienne accessoire. Ce n’est pas utopique : certaines villes conçoivent désormais des quartiers à mobilité douce ou collective. Cette conception d’une ville idéale pourrait faire l’objet du parcours ou de la séquence pédagogiques suivants !
Quels apprentissages de français ?
Si l’on destine une telle suite d’activités à des élèves de 15 ans au minimum, plusieurs fiches du programme de 3e et 4e années de l’Enseignement catholique général10 sont concernées :
L’UAA2 : « Réduire, résumer, comparer et synthétiser ». Il s’agit, dans notre séquence, de parvenir progressivement, au moyen du passage par deux groupes, à une synthèse collective de différents documents portant sur le thème de l’automobile et de son avenir. L’élève apprendra (ou s’entrainera) à sélectionner des informations clés dans des documents, à les intégrer dans une synthèse et à mettre en évidence, dans cette synthèse, des éléments de premier plan.
L’UAA4 : « Défendre oralement une opinion et négocier ». A la suite de cette synthèse collective, les élèves sont invités à partager leurs positions et à les étayer, sous la conduite d’un modérateur (l’enseignant). L’élève apprendra notamment à écouter activement autrui, à embrayer sur ce qui vient d’être dit, à exposer ses arguments de manière efficace (de façon audible, intelligible, marquante).
L’UAA3 : « Défendre une opinion par écrit ». A la suite du débat et en se nourrissant de celui-ci, afin notamment d'en conserver des traces, nous suggérons que les élèves rédigent un avis argumenté sur le thème débattu. L’élève apprendra ainsi à créer ou sélectionner des arguments pertinents, à les développer et à les lier les uns aux autres.
Pour conclure...
En feuilletant la Libre Belgique ce samedi 8 février, je suis tombé sur cette carte blanche de Pascal Warnier11, économiste et diplômé en sciences de l'éducation, qui résume parfaitement ma pensée… Enfin !
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été gagné par un profond malaise durant le salon de l'auto12
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été gagné par un profond malaise durant cette période de grande frénésie mercantiliste qu'est le salon de l'auto sur fond de crise climatique. Nous savons aujourd'hui que nous ne nous en sortirons pas sans modérer notre consommation. Nous savons que nos petits-enfants auront à souffrir de notre inaction car leur qualité de vie sera fortement détériorée.
Le salon de l'auto a eu lieu du 10 au 19 janvier dernier.
Durant cette période, la publicité en faveur de la mobilité automobile a été extrêmement intense dans tous les médias, vantant et idéalisant l'usage de la voiture. Le confort, le plaisir, la liberté, la sécurité, le design ont été portés au firmament pour inciter à l'achat. Un véritable tsunami d'images féeriques. Argument ultime, les nouvelles voitures présentées au salon sont, nous dit-on, pour la plupart écologiques parce que propulsées par l'énergie électrique. Et pourtant, nous savons ce qu'il en est de l'extraction et de la production des métaux rares nécessaires à ce nouveau type de véhicule, elles sont extrêmement polluantes et consommatrices d'énergie.
Cette exaltation de l'usage de la voiture est en profond décalage avec la nécessité de réduire les émissions du secteur du transport routier, responsable en 2022 de 22,4 % des émissions totales de gaz à effet de serre en Belgique (contre 14,4 % en 1990). Tous les voyants sont au rouge. Plus de voitures (54 % depuis 1990) sur nos routes, plus de kilomètres parcourus (39 % depuis 1990) et une augmentation limitée du nombre de passagers par voiture (26 %). Au même moment, la Californie et sa capitale Los Angeles étaient plongées dans l'abomination des feux de forêts allant jusqu'à dévorer les quartiers périphériques de la cité des Anges. Quelques semaines plus tôt enfin, le nouveau rapport du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) était dévoilé et sans grande surprise, il indique que les températures mondiales devraient grimper d'ici 2100 de 2,6 degrés par rapport à l'ère préindustrielle. [... Les] experts onusiens [répètent] une fois de plus la nécessité impérieuse "d'une mobilisation mondiale d'ampleur et d'un rythme jamais vus auparavant et ce dès maintenant".
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été gagné par un profond malaise durant cette période de grande frénésie mercantiliste sur fond de crise climatique. Nous savons aujourd'hui que nous ne nous en sortirons pas sans modérer notre consommation. Nous savons que nos petits-enfants auront à souffrir de notre inaction car leur qualité de vie sera fortement détériorée. L'humain est comme la terre, si sa température corporelle devait s'élever de 2.6 degrés, il ne pourrait subsister. Or, c'est la voie que nous empruntons pour le moment et qui ne semble pas être fondamentalement remise en cause. L'engouement pour le salon de l'auto apparaît à cet égard profondément anachronique tout comme le soutien inconditionnel de l'État à l'usage de l'automobile par une fiscalité plus qu'avantageuse des voitures de société.
[...]
Pierre-Yves Duchâteau
1. Dans un article du numéro de février 2025 (« Vos batteries vont-elles exploser ? ») du Monde diplomatique, le constat de la grande difficulté à recycler des batteries de plus en plus complexes est largement documenté. L’article se conclut d’ailleurs sur ces lignes : « Ainsi s’illustrent tous les paradoxes d’une transition fondée sur la possibilité d’un maintien sans dommage de notre mode de vie, alors que le recours massif aux batteries électriques ne fera qu’aggraver la crise environnementale. »
2. https://www.rtbf.be/article/cl..., consulté le 16 janvier 2025.
3. https://auvio.rtbf.be/media/te..., consulté le 16 janvier 2025.
4. IZOARD Célia (2024), La Ruée minière au XXIe siècle. Enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Editions du Seuil.
5. https://fr.linkedin.com/posts/..., consulté le 16 janvier 2025.
6. https://www.liberation.fr/idee..., consulté le 16 janvier 2025.
7. https://www.canopea.be/les-pet..., consulté le 16 janvier 2025.
8. Référentiel de français et langues anciennes (2022), Fédération Wallonie-Bruxelles
9. Meirieu Philippe (2022), « Travailler en groupe, oui… mais comment ? », dans L’Ecole des parents n°643, Editions Erès.
10. FESeC français (2018), Programme de français du 2e degré général.
11. https://www.lalibre.be/debats/..., consulté le 8 février 2025.
12. On écrit « Salon de l'auto », « salon de l'Auto » ou « Salon de l'Auto » ? Difficile de trancher ! Il semble à première vue que le recours à la majuscule soit proportionnel au respect que l'on voue à l'évènement. Et si l'on se réfère au Bon Usage (Grevisse et Goosse, Le Bon Usage. Bruxelles, éditions De Boeck, 2011), on n'est pas sauvés ! « Les noms de sociétés, d'associations, etc. prennent la majuscule au premier mot important. » Alors, « salon » ou « auto » ?


